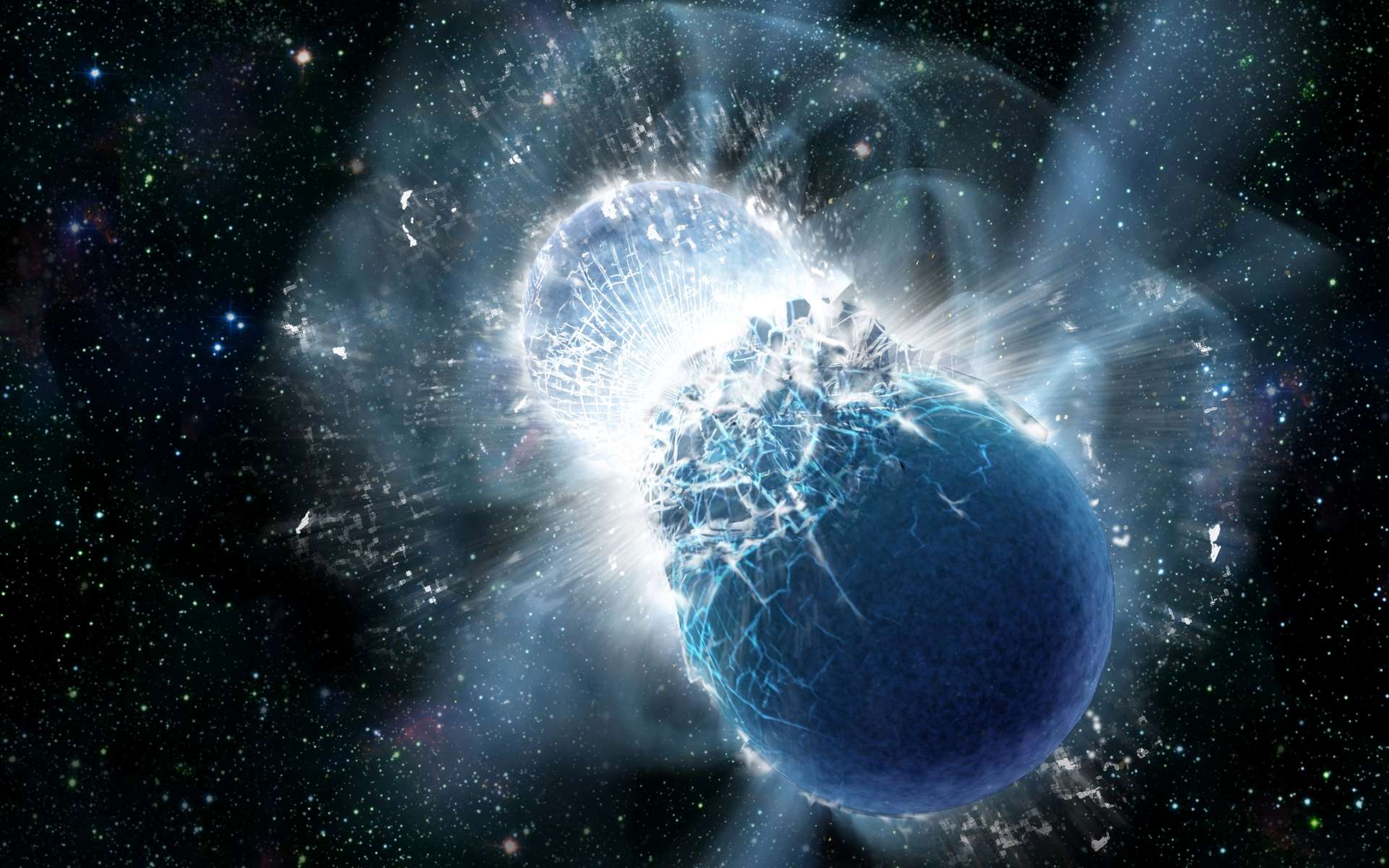
Si j’avais été une étoile,
Sans doute serais-je née, il y a fort longtemps,
Et pour descendre tel un soleil,
Je me serais parée de nos cheveux d’argents.
Si j’avais été une brillante étoile,
J’aurais animé de nos remous le ciel,
Fusionnée dans le vaste gouffre de mes affres,
Evanouie dans son intense regard,
Eteinte dans l’océan de mon chaos,
Dissoute dans l’extinction de notre union,
Puis, tremblante des vains mots.
Si j’avais seulement été son étoile,
Au coucher des deux pôles,
J’aurais mis en ébullition l’espace,
Vêtue de mes haillons,
Affranchi lacs et montagnes,
Cime de mes nuits sublunaires,
Les sables de mes cristaux de larmes,
Mes appels dans l’ombre crépusculaire,
Ondes d’une singulière mise à terre,
Indifférent joug de notre resplendissance,
Trépassant encore sous ses pas,
Transpirant de mille et un éclats,
Des lumières d’une aurore clémente,
Pleurant l’anneau de notre mariage,
Froid boréal d’un étonnant voyage,
Jusqu’au grand Nord, l’éternel Amour,
Jusqu’aux blancheurs de nos jours.






